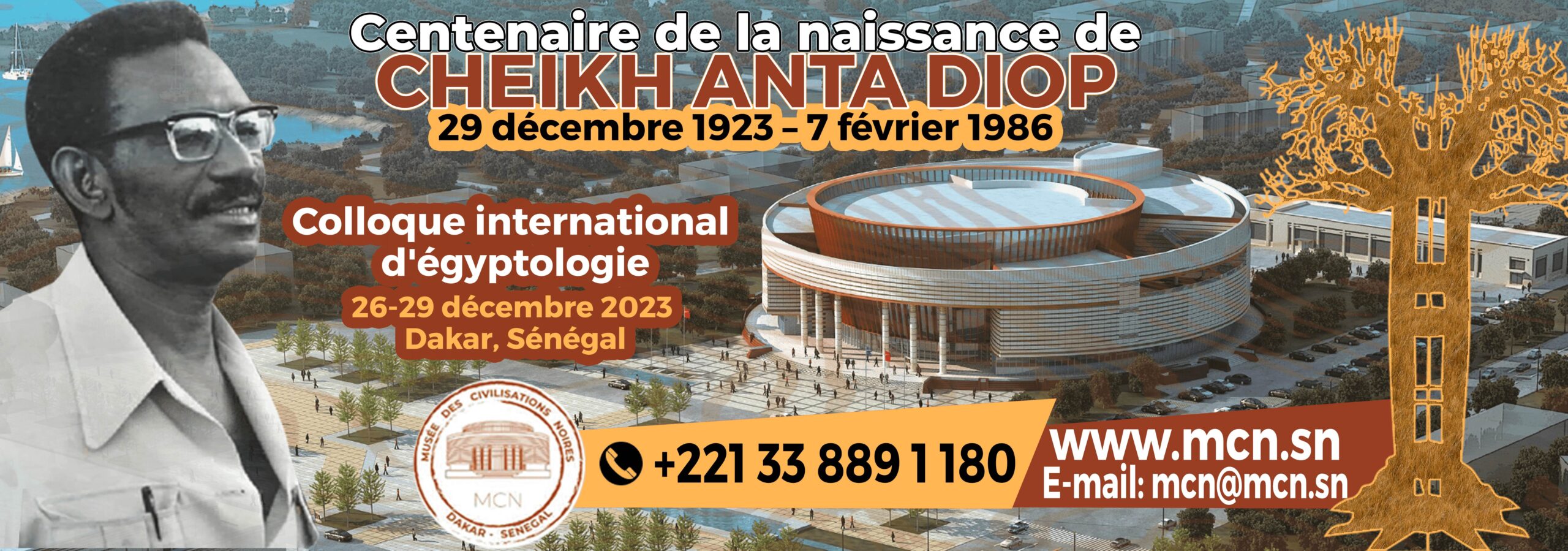La « Galerie de l’incivisme »
Le choix de dédier un espace à l’incivisme au cœur du Musée
des Civilisations noires qui se veut une fabrique continue de l’humanité
peut paraître paradoxal à bien des égards. Il l’est d’ailleurs, très
rigoureusement car le paradoxe est, dans son acception générale,
anomalie, extravagance, singularité, voire absurdité. Dans tous les cas, il
est hors normes. En conséquence, l’invite faite à l’incivisme dans nos murs
est pour le sortir de la banalité et de la confidentialité afin que sa posture
de déviant éclate au grand jour.
En raison du rôle central que joue la culture dans la fabrique
de l’humain, notre patrimoine culturel sera largement revisité car il ne s’agit
pas de convoquer le Civisme comme s’il s’agirait d’un comportement à
acquérir, d’établir qu’il s’agit d’un continuum à préserver à partir
d’instruments didactiques à adapter au langage de notre temps.
Cette exposition enfin, essentiellement audiovisuelle sera une
plateforme évolutive au service des citoyens, des artistes et activistes qui
luttent, au quotidien, pour promouvoir de bonnes pratiques dont les
services publics sont garants.
L’initiation, une fabrique de l’humain
Les remarquables capacités de résistance dont fait preuve les
sociétés africaines dans les épreuves que furent la Traite négrière et la
colonisation ne s’expliquent que par la culture. Une culture enracinée au
plus profond des êtres par un processus fusionnel qui lie l’homme à sa
société, à jamais. L’enfant qui sort de la forêt est une autre personne. Il
aura appris, à travers son parcours initiatique, à connaître « sa société
vraie », par opposition à celle « d’en face » pour reprendre une sagesse.
C’est dans ce refuge inexpugnable que l’Afrique a gardé son âme et
personne n’a jamais réussi à la lui reprendre. Osons assumer cette partie
de nous-même pour fonder une nouvelle humanité.
Au demeurant, contrairement à des idées reçues, l’éducation
traditionnelle en Afrique était un espace dédié tout entier à la créativité. A
travers son parcours initiatique qui est aussi socialisation, il produit, au
quotidien, par l’apprentissage ou sous la direction des aînés, une panoplie
incroyable de jeux et jouets qui sont autant de fenêtres ouvertes pour la
connaissance de la nature et la compréhension du sens des choses et des
êtres.
L’ouverture de cette galerie de l’incivisme n’est donc pas un
effet de mode. Il s’agit d’un combat pour nous et d’une levée de bouclier
contre nos travers. Dans cette entreprise qui s’adressera beaucoup à la
jeunesse, nous inviterons, régulièrement, à une revisite de notre patrimoine
culturel où les jeux, jouets, contes, légendes ainsi que les douces
berceuses de nos enfances plurielles devraient être réappropriés dans une
perspective didactique qui les mette, résolument au service de la société.
En somme, il nous faut promouvoir un africain inventif,
enraciné et apte à participer, non pas en qualité de spectateur, mais
d’acteur, à la société de l’information qui est, avant tout, celle des
producteurs.
Les expressions du pouvoir et de la citoyenneté, un antidote contre l’incivisme
Dans l’Afrique traditionnelle, l’expression du pouvoir était
encadrée par une série de conventions qui, tout en assurant son effectivité,
en endiguaient les abus. Si le chef avait un pouvoir, parfois d’inspiration
divine, le rituel imposait toujours les règles qui en atténuaient les
conséquences.
Pour cette première ouverture de la Galerie de l’Incivisme nous avons
décidé de convoquer la Charte du Mandé inscrite en 2009 sur la Liste
représentative du patrimoine immatériel de l’humanité tenue par
l’UNESCO. Sa valeur universelle exceptionnelle est décrite ainsi qu’il suit :
« Au début du XIIIe siècle, à l’issue d’une grande victoire militaire, le
fondateur de l’Empire mandingue et l’assemblée de ses « hommes de
tête » ont proclamé à Kouroukan Fouga la « Charte du Mandén nouveau »,
du nom du territoire situé dans le haut bassin du fleuve Niger, entre la
Guinée et le Mali actuels. La Charte, qui est l’une des plus anciennes
constitutions au monde même si elle n’existe que sous forme orale, se
compose d’un préambule et de sept chapitres prônant notamment la paix
sociale dans la diversité, l’inviolabilité de la personne humaine, l’éducation,
l’intégrité de la patrie, la sécurité alimentaire, l’abolition de l’esclavage par
razzia, la liberté d’expression et d’entreprise. Si l’Empire a disparu, les
paroles de la Charte et les rites associés continuent d’être transmis
oralement, de père en fils, et de manière codifiée au sein du clan des
Malinkés. Pour que la tradition ne soit pas perdue, des cérémonies
commémoratives annuelles de l’assemblée historique sont organisées au
village de Kangaba (contigu à la vaste clairière Kouroukan Fouga, de nos
jours au Mali, près de la frontière de la Guinée). Elles sont soutenues par
les autorités locales et nationales du Mali, et en particulier les autorités
coutumières, lesquelles y voient une source d’inspiration juridique ainsi
qu’un message d’amour, de paix et de fraternité venu du fond des âges. La
Charte du Mandén représente aujourd’hui encore le socle des valeurs et de
l’identité des populations concernées ».
Tout ce qui fonde le Civisme est dans ce texte qui est un remarquable
instrument au service du dialogue des cultures carrefour incontournable
pour la promotion du vivre ensemble.